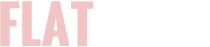La logistique urbaine
Négligé pendant de nombreuses années, le transport des marchandises en ville
350 vues
Introduction
Négligé pendant de nombreuses années, le transport des marchandises en ville, ou plus précisément, la logistique urbaine acquiert une croissante importance durant les dernières décennies (Durand, et al., 2010). Elle occupe une position de plus en plus significative autour de la thématique du développement durable (Allegre, 2016). Le transport des marchandises en ville représente, selon Savy (2015), environ 30% de l’occupation de la chaussée, 20% du trafic urbain et jusqu’à 50% des émissions de gaz à effet de serre.
Cette place, de plus en plus, prépondérante, l’est non seulement, de point de vue académique mais aussi en termes des initiatives entretenues par les professionnels. Comme l’indique Gardrat (2017), chaque secteur, chaque filière a sa propre organisation qui lui est spécifique. Pour accroitre les différentes dimensions de la performance, de nouvelles pratiques émergent intégrant un ensemble d’acteurs : la grande distribution, les entreprises de transport et logistique… (Dablanc, 2019). De nouvelles prestations voient le jour dans les villes, plus exclusivement, dans les zones denses comme les centres villes. Les grands distributeurs ont été pionniers dans ce sens, ils ont largement innové leurs stratégies et organisations logistiques. Le présent papier s’interroge sur l’effet des pratiques logistiques entretenues par les distributeurs sur la performance de la logistique urbaine.
Il vise à répondre aux questions suivantes : Quelles sont les pratiques adoptées par les distributeurs dans ce cadre ? Est-ce que ces pratiques améliorent-elles réellement la performance de la logistique urbaine ? Qu’entend-on par le concept de « la performance de la logistique urbaine ».
Le reste du papier est organisé en cinq sections : la section 2 présente la méthodologie utilisée pour sélectionner les articles à examiner. La section 3 présente une brève revue de la littérature. La section 4 décrit les résultats de l’analyse. La section 5 discute ces résultats. La dernière section conclut ce travail et fournit des perspectives et de nouvelles voies de recherche ainsi que les limites