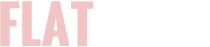L’impact des pratiques de SCM sur la performance de l’entreprise: une étude empirique dans le contexte français
Avec les années 90, face à la montée des contraintes concurrentielles, les organisations ont pris conscience
241 vues
Introduction
Avec les années 90, face à la montée des contraintes concurrentielles, les organisations ont pris conscience qu’il n’était plus suffisant d’améliorer l’efficacité uniquement à l’intérieur des frontières de l’entreprise, mais qu’il était nécessaire de rechercher des gisements de compétitivité à l’échelle du système de valeur3 (ou supply chain) tout entier (Li et al. 2004). Dans cette optique, le Supply Chain Management (SCM) apparaît comme le moyen de développer un avantage concurrentiel. Grâce à une gestion collaborative des relations au sein du système de valeur et à une coordination intégrée des processus, du fournisseur initial jusqu’au client final, le SCM vise à créer plus de valeur à la fois pour le client et pour les entreprises (Cooper et al. 1997 ; Filbeck et al. 2005), améliorant de ce fait la performance de chacune des organisations et du système de valeur dans sa globalité (Koh et al. 2007). Cependant, malgré cette attention croissante portée au SCM, deux insuffisances de la littérature existante doivent être soulignées : la première concerne l’appréhension et la caractérisation du concept de SCM, la seconde intéresse les liens entre SCM et performance.
Malgré l’abondance de la littérature dans ce domaine, l’appréhension du concept de SCM souffre d’une absence de consensus qui transparaît sur trois éléments. Le premier élément concerne la confusion conceptuelle qui touche la notion même de SCM. En effet, la définition du SCM reste peu claire, et il n’existe pas véritablement de consensus sur cette question (Gibson et al. 2005 ; Mentzer et al. 2008). Au-delà de la définition de ce concept, il n’existe que peu d’apports relatifs à la mise en œuvre concrète du SCM dans l’organisation et à l’identification des dimensions constitutives de cette notion, c’est-à-dire aux « pratiques » de SCM (Li et al. 2004) ou PSCM. Le deuxième élément renvoie aux dimensions constitutives du SCM réellement prises en compte dans les études empiriques, et qui apparaissent relativement fragmentées (Chen et Paulraj 2004 ; Li et al. 2005 ; Li et al. 2006). Enfin, le troisième élément touche à l’opérationnalisation des dimensions constitutives du construit SCM sous la forme d’une ou plusieurs échelles de mesure. Là encore, coexistent dans la littérature des échelles multiples visant à rendre compte du concept de SCM, mais sans véritable homogénéité (Min et Mentzer 2004 ; Li et al. 2006 ; Chow et al. 2008).
La seconde insuffisance concerne l’analyse des liens entre SCM et performance. S’il existe effectivement de nombreuses études mettant en relation les PSCM et le développement d’un avantage concurrentiel, elles restent néanmoins, le plus souvent, à la fois dispersées et incomplètes (Koh et al. 2007). Tout d’abord, elles sont peu nombreuses à faire l’effort de préciser ou d’expliciter la relation entre ces deux variables, traitant le plus souvent ce phénomène comme une « boite noire ». En outre, ces études sont souvent concentrées sur certains aspects locaux du SCM et portent par exemple sur les relations de l’entreprise avec ses fournisseurs (Chen et Paulraj 2004), sur l’intégration des systèmes logistiques au sein de l’entreprise (Rudberg et Olhager 2003) ou sur les relations de l’entreprise avec les distributeurs (Tan et al. 2002). Si certaines études existent qui tentent d’appréhender simultanément les liens amont et aval au sein du système de valeur, elles restent relativement rares (Li et al. 2004). D